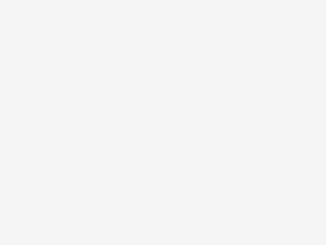Par Gabriel Robichaud, correspondant Frye
Alexandre Dostie arrive dans ma vie avec son percutant recueil de poésie Shenley, publié aux Éditions de l’Écrou, dont l’exergue citée de son père, Chez nous/C’est là où/J’accroche ma calotte suivi du poème Deux œufs bacon font de sa plume un objet de référence instantanée. Poète, réalisateur, scénariste et autres tâches connexes, c’est avec Que ceux qui m’aiment me sauvent que le Festival Frye accueille pour la première celui qui s’est déjà fait tatouer à Moncton à l’adolescence lors d’un voyage touristique familial à Shédiac que la pluie mettait en péril. C’est au Club Café, coin Saint-Denis et Roy, en fin de parcours de la série de représentations de Parler mal au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, et à quelques jours de l’annonce de la production de son premier texte solo pour le théâtre, Kiki et la colère, que je rencontre cette personne que j’admire de loin pour une « vraie première fois ».
Tu te définis comment? Si tu te définis…
C’est une bonne question. Je dirais un genre de col bleu de… Je sais pas, j’essaie de raconter des histoires pis d’explorer, de comprendre, de me comprendre. Un genre de col bleu du storytelling.
Pour moi, c’est une aventure à chaque fois. Un mélange entre l’aventure pis le grind. C’est dur à définir. Y a des jours où t’es câlissement inspiré parce que t’as eu une bonne journée d’écriture, où t’es capable de donner une réponse très sharp, assumée, inspirante, pis t’as d’autres jours où tu te fais ramasser par l’impôt pis que tu sais pas comment tu vas faire pour te débrouiller pour faire vivre ton kid qui s’en vient pis tu te demandes quelle étiquette mettre sur c’t’ostie de vie bizarre que t’as choisie.
Je te dirais que dans mes meilleurs jours je suis capable de traduire de l’abstraction pis capable de leader, porter une vision, pis dans les cinq autres jours de la semaine, c’est plus grinder à la pioche. T’es un secrétaire, un comptable pis un hôtelier parce que t’essayes d’arrondir tes fins de mois en louant ton chez vous dans une autre ville sur Airbnb. Tout ça en même temps.
Shit… Tu vas te débrouiller avec ça? (rires)
Oui oui. C’est pas une question simple, mais ça casse bien la glace.
Ça casse la glace d’aplomb.
Tu fais du cinéma, tu fais de la poésie, t’écris une pièce de théâtre. Qu’est-ce qui fait qu’un projet de création prend une forme ou une autre?
C’est des voix, des hantises, des obsessions. Je me sens souvent commandé. J’ai tout le temps plein d’idées, de débuts d’histoires, de cahiers, de trucs qui m’inspirent, mais y a des idées à moment donné qui s’imposent pis elles viennent avec un souffle, avec une forme, pis des intentions pour atteindre, toucher du monde, parler au monde, faire triper le monde. Moi, en gros, j’essaie juste d’écouter ses affaires-là. Comme je sais que la poésie, c’est un désir d’intimité avec le lecteur. Pis le cinéma c’est comme un désir de rêver avec le spectateur. Pis là, avec le théâtre, c’est un désir presque de physicalité avec le spectateur. Donc chaque projet vient avec un désir de contact différent, une charge différente, pis c’est comme ça que je l’expérimente. Ça se décide un peu tout seul, sans moi. Pis y a tellement de trucs qui sont dans les tiroirs en ce moment parce que j’ai pas encore figuré out comment les communiquer… Ça reste à découvrir.
J’ai fait de la musique aussi, pis encore là c’était un désir de contact physique, de sentir la room. C’était un peu comme la poésie. La poésie, j’en écrirais pas si je ne pouvais pas la lire. Dans la poésie, autant dans sa forme sur la page que la raison pour laquelle je la fais (la dire), y a ce désir d’intimité, de me sentir proche des gens, de sentir ce que ça leur fait quand je leur dis ça, de sentir ce que ça me fait de communiquer ces affaires-là idées-là.
Je te pose une variation sur une question qu’on m’a déjà posée qui disait à peu près « te considères-tu plus un comédien qui écrit ou un auteur qui joue? ».
Donc, te considères-tu comme un cinéaste qui écrit ou un auteur qui fait des films, ou je m’en torche, ou, un peu des trois?
Ça dépend des jours. On set, je me considère crissement comme un cinéaste. J’aime beaucoup être sur un set. C’est des moments qui sont tellement précieux pis pour lesquels tu travailles tellement fort. Mon dernier short film, ça a été deux ans et demi d’écriture, de développement, pour arriver à une coproduction France-Québec d’un truc vraiment fucked up et dur à produire. Pis je chéris beaucoup les moments où enfin on arrive, où l’équipe est là pis t’es pu tout seul à porter ta vision, pis on communie autour de l’idée, pis là ça apparait devant nous autres pis ça dépasse nos attentes.
Faire du cinéma, c’est toujours patcher parce que tout pète tout le temps. En même temps, être ensembles pour tenir le bateau à flots pis finalement voir la vie pénétrer ça, pis les surprises, c’est la plus belle affaire. Pis je le sais qu’y a plusieurs cinéastes qui ont de la misère à apprécier ça pis à s’y abandonner, mais moi je trouve la chance de le faire pis ça me fait tellement du bien. Donc quand je suis on set pis que je dirige, je me sens 100% cinéaste.
Après, l’écriture, c’est quand même difficile, mais pas pour la poésie, tu vois. Écrire du cinéma, pour moi, c’est difficile. Mais quand je suis poète, je me sens poète. Je me sens toutes ces affaires-là, en fait. Pour moi, ce n’est pas mutuellement exclusif. L’un nourrit l’autre. Même quand j’écris du théâtre, je me sens dramaturge. Mais je suis jamais tout à fait convaincu de ses affaires-là. Ça vient toujours avec un questionnement, un doute.
Comme une imposture?
Peut-être. C’est un doute de « pourquoi je fais ça? Je vais tu être capable de le faire? C’est tu de la marde ce que j’écris? » Tout questionnement de n’importe quel auteur qui se respecte, au fond. J’aimerais ça, un jour, faire la paix avec ça. Juste accepter que j’ai choisi de…
De pas être content? (rires)
C’est ça (rires). J’ai choisi de ne pas être content.
J’ai fait un burnout y a de ça deux ans. Au même moment, ma psy me disait « je pense que t’es en burnout », ma blonde me disait « t’es en burnout depuis que je te connais » pis mon producteur me disait « t’es en burnout depuis 2018 ». J’ai une amie qui m’a proposé d’aller travailler dans un cimetière dans ce temps-là.
Je pense d’ailleurs que c’est ce que j’aurais fait si j’avais fait autre chose. Je pourrais pas être comptable. Même des métiers connexes comme la pub, je pense que sitôt que t’engages ton créatif là-dedans… en tout cas si moi je le fais, je serais faite. On pense que ce sont des métiers connexes, mais pas pour moi. Je pense que d’écrire de la poésie ou du cinéma c’est plus proche de travailler dans un cimetière. Pis en même temps, je l’ai pas faite. Je suis encore en train d’écrire.
C’est quoi la question qu’on ne t’a jamais posée sur ton œuvre ou que t’aimerais qu’on te pose? Et/ou c’est quoi la question que t’es écoeurée qu’on te pose?
Honnêtement, je ne me souviens jamais d’une entrevue à l’autre. On pourrait sans doute compiler tout ce que j’ai dit pis que j’aie dit tout et son contraire. J’ai pas vraiment de cassette. Pis en même temps, je me sens habité par pleins de contradictions qui doivent transparaitre. Mais ta première question est bonne. Quelle question que j’aimerais ça qu’on me pose?
Note au lecteur. Je trouve toujours ça difficile de traduire le silence habité par la réflexion d’un interlocuteur. Je tiens à dire qu’Alexandre, ou Dostie, pour les intimes, a réfléchi longtemps à cette question avant de me répondre :
C’est vraiment une bonne question. On y revient tu plus tard?
Dans ton processus de création, c’est quoi la place que t’accordes au réel et/ou à la fiction?
Pour moi, c’est pas mal la même affaire, les deux. Dans le sens qu’y a des fictions qui sont plus vraies que bien des réalités factuelles, pis c’est ce qui m’intéresse, ce que j’ai envie de mettre à jour. La superposition du réel et de la fiction qui crée quelque chose où tu ne sais pas délimiter le vrai du faux, et où la vérité finit par se trouver pareille.
Je veux m’assurer de bien saisir. Parfois, quand j’écris, j’insère ce que j’appelle des « ancrages de réalité » dans mes œuvres, c’est-à-dire des petits bouts où je fais appel à quelque chose que je connais, qui m’est arrivé, ou qui m’a été raconté, mais qui, au final, n’est plus important lorsque l’œuvre finale arrive. Est-ce que ce dont tu parles fait écho à ce type de procédé?
Je dirais que mon rapport à la fiction/réalité, c’est plus de l’ordre de l’esprit. C’est dans l’esprit d’un moment, d’une histoire, de l’expérience humaine. Ça va avoir l’air bizarre, mais pour moi c’est plus de l’ordre du spirituel. Que ce n’est pas forcément vrai factuellement, mais vrai dans l’esprit que j’essaie de dire. Donc oui, des fois, ça va être groundé dans un lieu, un souvenir, quelqu’un que j’ai rencontré, mais dans la transformation qui s’opère au moment de tisser l’histoire, tout ça descend dans ce que j’essaie de faire vivre ou de raconter, pis ce que ça devient est plus important que là d’où ça pouvait venir.
Un des trucs qui me reste en tête, c’est que je ne pense pas avoir une bonne mémoire factuelle quand vient le temps de me souvenir, mais j’ai une bonne mémoire du feeling que je vivais dans un moment. C’est ce qui m’intéresse le plus, ce que je trouve plus beau, parce que pour moi ça crée un espace où le lecteur ou le spectateur peut se projeter. Parce que la réalité factuelle, dans sa précision ou son détail, c’est plus difficile parfois de s’y projeter.
Dans les poèmes que j’ai lus entre Shenley et Que ceux qui m’aiment me sauvent, tu sembles souvent changer l’adresse, entre le « je » et le « tu ». Qu’est-ce qui impose ce changement-là?
C’est instinctif, surtout. Mais ça reste des « tu » qui appartiennent au « je ». « La fille », « le père », « le boss », « la serveuse au bar », « la psy », quand ils sont rendus dans le poème, c’est des parties de moi. Peut-être un peu la même affaire que la réalité pis la fiction qui deviennent fluides pour moi rendus là.
C’est drôle que tu poses cette question-là, parce que ça m’arrive qu’on me dit « y a un elle qui apparait, est-ce que c’est voulu »? La plupart du temps, je dis « j’ai mis une « elle », mais en même temps ça pourrait être encore moi qui me parle, parce qu’au fond je me parle à moi-même avec la voix de cette personne-là ». Dans les films, je trouve que ça ressort de manière plus flagrante qu’en poésie (mais je trouve ça hot que tu le sortes en poésie). Je me retrouve dans tous les personnages de tous mes films. J’ai de l’amour même pour le tueur, le père indigne, parce qu’y a une partie de moi dans tous ces personnages-là. Je leur greffe une partie de moi pour essayer de les comprendre pis de relate pis de pouvoir comprendre quoi écrire pour eux autres.
Y a une chose qui m’est apparue, c’est une espèce de dynamique, de tension, j’ai envie de dire une relation amour/haine entre la dimension d’appartenir à une périphérie pis de côtoyer un centre. C’est rare que j’ai lu de la poésie québécoise qui parle de Montréal comme une île, mettons. C’est quoi la place que ce type de dynamique-là occupe dans ta création?
C’est que je la vis, cette tension-là. Elle existe, pis je la vois, je trouve… Quand je viens à Montréal, quand je me promène, quand je pense à c’est quoi le Québec pour moi ou quand je repense à ma Beauce natale. Quand je compare mon contact avec ma région d’origine, ma région d’adoption (Trois-Rivières) pis mettons Montréal. C’est vrai que je la sens, la tension. T’sais, je pense qu’y a un grand besoin d’être compris pis de se faire comprendre dans « pourquoi je fais ça » pis « pourquoi c’est plus fort que moi ». Pis je pense que cette affaire-là d’être compris, je le feel entre les régions, entre les classes sociales. Pis je trouve qu’on se comprend mal.
Mettons, on est à Montréal, je sens pas qu’il y a un intérêt réel pour la région, je pense pas qu’on veule comprendre les gens de la région, je pense qu’on les case rapidement… Je pense pas qu’on a d’intérêt sensible… Pis peut-être vice-versa aussi… Pis je trouve ça dommage quand même, pour une province qui a déjà voulu être un pays, pis pour un Québec aujourd’hui qui se veut plus divers et inclusif, je trouve qu’on passe quand même à côté de quelque chose, ne serait-ce que dans nos rapports géographiques et social. Pis je trouve que c’est une perte, en fait, culturelle, pis humaine.
Je t’écoute, pis j’ai l’impression que je pourrais utiliser des mots similaires pour parler de la posture par rapport à ce type de dynamiques-là. Entre autres, quand on entend dans des médias dits nationaux parler du terme « en région », c’est rarement « en région », c’est plutôt « hors Montréal », alors que c’est une région comme une autre.
C’est vrai que c’est très montréalocentré, pis toutes les questions qui peuvent être soulevées sont tout le temps regardées par le prisme de Montréal, pis on essaie pas de comprendre, mettons, pourquoi le monde sont différents, mais y ont leurs raisons pis je pense qu’à force d’être pas compris, on se cantonne, on se bucke, pis on fait fuck off, pis on y va avec des coups de gueule à la place, parce qu’y a toujours l’espoir d’être compris, mais moins on est compris, pis plus on y va en coups de gueule pis plus on y va avec des anyways, fuck it.
Pis honnêtement, même dans le cinéma québécois, je trouve que depuis 10 ans y a une vague qui se dit « on va faire une film de régions ». Je trouve que c’est folklorisant, je trouve que c’est insensible, je trouve que ça parait que c’est du monde de la ville, ou du monde de région que ça fait longtemps qu’ils n’y sont pas retournés pis qui s’en calissent qui font des films de région. Je trouve que c’est grotesque, insensible, opportuniste, pis honnêtement, dans 90% des cas, ça me fait fucking chier. Pis je trouve que la région sert souvent comme décor dans le récit d’un drame familial exotique, pis je trouve ça idiot, pis je comprends les régions du Québec de sentir un regard condescendant de Montréal sur eux. Pis j’ai tout mon respect pour les gens qui les habitent pis qui créent à partir de là.
Tu le dis, pis je me rends compte qu’à peu près tout ce que je consomme comme culture à grande échelle en français au pays, ou qui se rend chez moi, passe par ce prisme-là, ou a filtré selon des critères subjectifs qui relèvent de cet ordre-là.
J’imagine, aussi, à Moncton, avec le Nouveau-Brunswick [que c’est similaire]. Reste que je trouve que quand on en entend parler [de Moncton, du NB, de l’Acadie], ou qu’on la voit, ça se fait avec une fierté qu’on peut envier. C’est ce que je trouve très hot de l’Acadie telle que je la connais ou la perçois.
Je vous épargne une partie de l’échange où se déploie une série d’anecdotes et de réflexions sur la question du pays et de la fierté, mais qui finit par se résumer par une phrase sur laquelle on s’entend tous les deux : la culture est plus grande que le pays.
J’ai eu l’impression que Shenley avait quelque chose, un peu, du « procès » ou du retour sur la vie de l’adolescent, et que « Ceux qui m’aiment me sauvent » était plus un « procès » ou retour sur une vie plus adulte. Je ne sais pas si c’est quelque chose qui t’as habité, mais comment perçois-tu l’évolution de l’écriture d’une livre à l’autre?
J’aurais pas dit procès, mais comme le ton est dur, ça feele peut-être procès.
J’étais pas sur de mon mot. (rires)
Dans Shenley, y a deux parties : la faune et la fleur. Pis c’était un peu de voir comment l’environnement formait ou forgeait la jeune créature, la jeune fleur, la jeune pousse que j’étais pis qui a poussé en Beauce. L’idée c’était de faire ce rapport-là dans tout ce qui a de beau, dans tout ce qui a de laid, pis dans toute la force vitale, le rêve pis l’innocence de de la jeunesse en Beauce. En essayant de retourner dans l’émotion de ce que c’était.
Pour Que ceux qui m’aiment me sauvent, je trouve ça intéressant qu’il y aie du temps qui soit passé entre les deux. Je ne me serais pas vu sortir un livre après [Shenley]. J’aime ça de voir comment le Alex de Shenley évolue 8 ans plus tard. Je trouve ça intéressant de voir comment certaines émotions, certaines visions, mettons, plus romantiques, [comme] le rêve, demeurent. C’est la même chose avec la colère, le sentiment d’être incompris, cette recherche de soi, cette quête qui dit « je suis pas garagiste comme mon père, mais j’ai le même ostie de grit et cette envie d’être en contact avec les choses ». Je trouve ça intéressant de voir comment cette ombre-là, de celui qui aurait dû se sortir d’où y a grandit, mais dont l’ombre continue de le suivre et de lui coller à la peau, pour le meilleur et pour le pire [vit dans le livre]. Dans Shenley, c’est plus un constat du bagage que j’ai et de comment m’en définir, alors que dans Que ceux qui m’aiment me sauvent y a plein d’affaires dont j’aimerais me débarrasser ou intégrer, pis qui tente de faire ce chemin-là.
Mais y avait pas d’intention, mettons, meta, quand j’ai écrit Que ceux qui m’aiment me sauvent. J’ai accumulé des polaroids pendant les 8 ans entre les deux publications, pis dans le collage, ça fait un espèce de portrait de cette époque-là. Ce qu’il y avait de conscient, par contre, c’était le désir de montrer une vulnérabilité pis des cotés pas beaux, de les assumer, parce que tout le monde en a. Je trouve que parfois les gens écrivent de la place où y ont compris qu’à moment donné ils ont été une marde pis pourquoi ils l’ont été, alors que moi j’essayais d’écrire dans l’expérience du mal de vivre plutôt que dans le bilan de ce qui a été.
On m’a déjà parler de l’anecdote du lancement de ton recueil Shenley dans une foire agricole en Beauce, mais si t’es pas écoeuré d’en parler, je serais curieux de t’entendre la raconter.
Pour moi, à posteriori, cette expérience-là témoigne bien d’à quel point l’Écrou était une maison d’édition hot et investie dans ses auteurs pis dans ce que ça veut vraiment dire faire de la poésie. C’est vraiment un témoignage des grands cœurs de JS Larouche et de Carl Bessette, le rapport humain de la poésie.
La petite histoire, c’est lorsqu’ils m’ont demandé « Où on sort Shenley? », j’ai répondu « À Shenley… à la foire agricole de Shenley. Y a pas meilleure place. »
C’est quoi cette foire agricole-là?
C’est une foire agricole qui doit être aussi vieille que le village. C’est rien d’extravagant, mais c’est aussi ce que Shenley a de plus nice à offrir, parce que tout le village se rassemble pour boire des coups, pour checker des tracteurs, pour boire de la tire de poney, pour gager de l’argent, pour voir des shows country, pis crier, pis cruiser, pis rire. Ça dure une semaine. Y a des concours de génisses… Le rapport à la terre, à la culture agricole, la culture et à l’agriculteur… C’est vraiment hot.
Pis quand je leur ai dit « on fait ça là », au lieu de me répondre comme 99% des éditeurs qui diraient « ouan, mais là, on ne peut pas vraiment se l’offrir, je crois pas qu’on vendra assez de livres là-bas », pis toutes les affaires que t’as besoin de répondre quand tu t’institutionnalises… Ben eux, y avaient pas ces concerns-là, pis y ont dit « go! On y va! Pis on amène d’autres auteurs de l’Écrou! ». Pis là Carl (l’un des éditeurs) s’est mis sur le téléphone pis a loué un stand à la foire, entre le cercle des fermières pis la machinerie agricole pis un gars qui vend des talismans.
On est débarqués là avec Maude Veilleux, Carl Bessette, Jean-Sébastien Larouche, on a été là pendant 2-3 jours. Moi ça faisait un boute que j’étais pas passé à Shenley, pis j’étais rendu avec une grosse barbe, pis le monde me reconnaissait pas. Le mot s’est passé qu’y avait des poètes pis le monde si disait « c’est qui ça, tabarnac », pis le monde disait « ben, c’est le petit Dostie », mais on me reconnassait pas…
À moment donné, je m’enligne au bar pis je croise le Pit qu’on retrouve dans Que ceux qui m’aiment me sauvent. Mais le Pit, c’est un road warrior, un personnage à Shenley, un grand coeur, un curieux, un sensible avec un sens de l’observation débile avec sa vie à lui. Pis c’est le premier qui m’a aligné au bar. Il s’est assis à côté de moi avec sa bière en me disant « P’tit Dostie? ». C’est le premier qui m’a reconnu. Y a passé les 2-3 jours au stand avec nous. Plein de mondes qui sont venus me voir, mes profs au primaire, mes amis, mes bullys qui sont venus me voir au stand pis qui ont acheté des livres.
Mais le clou, c’était un soir où y avait un talent show, où la plupart du monde c’est du monde de genre 12-18 ans qui font genre un tour de magie, ou une fille qui fait un cover de Shania Twain (alors que moi j’ai genre 30 ans), pis mes éditeurs me disent « go, t’es pas game ». Pis le show se passe, pis finalement, y m’oublient presque. La dernière fille qui avait passé avant mon tour, c’était celle qui faisait un cover de Shania Twain, elle était fucking bonne, elle était toute habillée en noir, les cheveux noirs, une guitare noire, fucking belle, pis tout le monde criait « YEAHHH SHANIA TWAIN » parce qu’ils la connaissaient. Elle a fini, tout le monde a capoté, pis l’animateur dit « faites vos votes, c’est fini! ». Pis c’est là que je fais « wô wô wô! y a moi! ». Ça fait que finalement l’animateur dit « ah ouan, c’est vrai, y a un poète ». Pis là je sens tout le chapiteau se refroidir. (rires)
En même temps, j’ai retrouvé mon ground là-dedans, parce que c’est des poèmes qui parlent de ce monde-là avec amour, humour, dans notre langue de la Beauce, pis finalement j’ai lu des poèmes pendant 10 minutes pis le monde hurlait. Le monde était wild, pis ils voulaient pas que ça arrête. C’était tellement cool de voir mon village qui étaient là à triper avec moi, pis à se reconnaitre là-dedans. Pis finalement, ostie, je suis arrivé 2e, derrière Shania Twain! J’ai eu un chèque de 100$, pis on l’a bu. (rires)
Pis ça a été ensuite voir des gars qui n’ont pas toujours été nice (bon, on était jeunes, c’est la vie, c’est correct), mais les voir avec mon recueil de poésie fourré dans la poche arrière de leurs jeans c’était crissement hot.
Fait que ça c’est l’anecdote, pis sans l’Écrou, ça aurait été absolument impossible.
Je suis curieux de t’entendre sur l’exergue de Shenley : Chez nous/C’est là où/J’accroche ma calotte, citation de ton père, parce que pour moi ce sont les premiers mots que tu publies, pis je trouve ça beau.
Y a quelque chose pour moi de la souveraineté individuelle, le choix d’accrocher sa calotte quelque part, le choix de faire sa maison quelque part avec des gens, de faire ce choix-là au lieu d’un autre. Ça parle beaucoup. Où on se dépose, c’est des endroits où on va laisser des traces, pis qui vont marquer, qui vont marquer leurs traces. Pour moi, l’histoire d’un individu pourrait être retracée à tous ses endroits où y a décidé d’accrocher sa calotte. T’accroches ta calotte chez ta blonde, t’accroches ta calotte chez vous quand t’es petit, dans un premier apparte… Y avait cette idée-là, pis aussi je trouve que ça parlait aussi de la Beauce. Parce qu’en Beauce, c’est des lifestyles un peu plus sédentaires, donc ça a encore plus de poids, la calotte est plus lourde, pis le crochet doit être encore plus solide. Pis je trouve ça beau. Je trouve ça beau de choisir un lieu.
Pis je trouve ça beau aussi de quitter, parce que ça commence avec cette exergue-là, mais Shenley, ça demeure l’histoire d’un kid qui a grandi là, mais qui décide aussi de partir.
Là, à partir d’ici, y a des questions qui sont weirds. Voici les questions que je ne t’aurais jamais posées, mais que toi t’as posées dans tes recueils, et que je te pose parce que tu les as déjà écrites.
Nice!
Les prochaines sont de Shenley.
Y viens-tu de fesser un gars avec une queue de billard? (p. 34)
J’espère que oui (rires). Moi, j’ai un rapport intime avec la violence pis la colère. Je pense que la colère c’est une de mes premières émotions. Pis on est à une drôle d’époque pour les gens en colère. C’est comme si on pouvait facilement choisir de faire sans cette colère pis cette violence-là.. Mais c’est pas si facile. On est dans une société qui est sensible à d’autres émotions : la tristesse, la déprime… Je pense qu’on est plus sensibles à ces émotions-là, mais la colère on ne sait pas comment l’aborder, pis par conséquent, on refuse de la comprendre. Pis ça, je trouve que ça génère plus de colère.
Je dis pas ça pour enlever la responsabilité sur les gens en colère, mais quand t’es triste, y a une partie de toi qui va se consoler tout seul. On va s’attendre à ce que tu aies un minimum d’autonomie, pis c’est correct, mais tu vas aussi trouver des oreilles attentives pour te consoler et la comprendre, ta peine. La colère, je trouve qu’y a moins de gens qui sont intéressés à comprendre cette affaire-là, pis c’est plus vu comme un trait dont on devrait se débarrasser. Mais c’est une émotion, t’sais. Y a beaucoup de ça en dedans de moi, y a beaucoup de ça dans mes poèmes, pis on sait pas trop quoi faire avec ça dans notre époque.
Moi, je consulte. J’ai slacké full l’alcool, etc. Mais même à ça, c’est encore là. On vit tellement dans un monde injuste, insensible, absolument hypocrite, pis ça me met en tabarnac, pis c’est dur… J’ai de la misère à gérer ce sentiment-là. L’injustice, ça me met en colère, pis je sais pas trop quoi faire avec ça.
Heureusement, y a la poésie. Heureusement, y a le cinéma. Heureusement, y a le théâtre. Tu vois, ma pièce, ça s’appelle Kiki et la colère, pis c’est l’histoire d’un gars qui perd son cockatiel, pis qui est pogné pour grimper dans un arbre pour le rattraper, pis y est tellement en tabarnac à moment donné qu’y veut pas descendre. J’explore ça.
Fait que la baguette de pool, c’est un peu ça. Pis dans ce poème-là, c’est un peu drôle. C’est un poème qui fait rire, t’sais. Ça devient comme le visage héroïque de la colère. Parce que ça sert à de quoi la colère, quand même. Mais on ne nous dit pas à quoi ça sert, on n’est pas dans un monde qui nous dit à quoi ça sert. On nous dit de cacher ça, de gérer ça de notre bord, de revenir quand on ne sera plus fâché… « Cachez cette colère que je ne saurais voir ».
C’est pas pour rien qu’on est dans une société qui ne peut pas dealer avec la colère. Je trouve que la société est tellement fucked que la colère, c’est ce qui va la mettre à terre. C’est la façon que le monde dans lequel on vit a de se protéger : ridiculiser cette colère-là, de dire qu’elle est immature, qu’elle est toxique, qu’elle est nuisible…
Les eaux qui dorment?
C’est les eaux qui dorment jusqu’à ce qu’elles ne dorment plus.
Je peux pas m’empêcher de faire le lien avec un entretien que j’ai fait avec Jean-Philippe Pleau la semaine dernière et qui me disait qu’on ne lui parlait jamais de la colère ou de la violence qu’il y avait au cœur de Rue Duplessis. C’est weird de voir cette connivence-là apparaitre. Mais je comprends ce que tu dis, pis je suis d’accord avec toi.
Non mais je suis content de pas être le seul à faire l’expérience de ça, pis qu’on partage ce sentiment-là. Peut-être que comme ça, on finit par trouver à quoi ça sert, pis on arrive à mieux la comprendre pis à mieux la canaliser, au lieu de l’enterrer… Parce que ça sert à quelque chose, c’est sûr que ça sert à quelque chose.
On est dans un confort inédit, pis on est pas adapté à ça, pis c’est à se demander si ce confort-là est même naturel pour notre espèce. Mais bref, c’est une autre histoire.
Peux-tu vraiment m’en vouloir si je veux que ça finisse avec éclat? (p.47)
C’est encore ça. C’est comme, à défaut de vivre pour quelque chose, mourir pour de quoi. Chercher du sens quand pu rien n’en fait. C’est le hail mary pass pour essayer de changer son sort, un dernier coup de dés face à l’impuissance.
Peux-tu vraiment fronter ma face dans le café de la poly? (p. 58)
Ça, c’est mon adolescence. Beaucoup de masques. Des beaux masques. Pis toujours ce désir-là d’être compris pis aimé. Espérer trouver quelqu’un qui peut fronter ta face, parce que même toi t’es pas capable de la fronter.
C’est encore dur. C’est dur de savoir c’est quoi ta face, en fait. On met tellement de masques par-dessus des masques. À moment donné, t’as 12 masques dans la face, tu le sais pas, pis là tu commences un travail sur toi pour enlever les masques pis t’en enlèves 8… Pis là, à 8 masques, tu te dis « yo, ça doit être moi, ça ». Pis là tu touches ta face, pis ça fait tellement longtemps qu’y sont là ces masques-là que tu peux croire que c’est vraiment ta face…
Me laisseras-tu te montrer mes coupures?
Me vois-tu quand je rêve d’ailleurs?
Me suivras-tu si je pars d’ici. Loin. Genre, au cégep? (p.59)
La même affaire qu’avant. Des questions qui espèrent la même réponse. C’est : « est-ce que toi tu vois qui je suis, parce que ça m’aiderait, parce que je sais pas moi-même. Y a des jours que je sais, des jours que je sais pas, peux-tu m’aider à démêler tout ça? » Pis « j’espère que ça te fera pas peur, j’espère que tu partiras pas, si tu vois mon vrai visage ».
Je trouve ça intéressant le choix de « genre » au cégep. Y a un doute qui s’installe. La question du « c’est quoi, loin? » aussi.
T’sais, au secondaire, j’avais pas vraiment d’horizon sur ce que j’allais faire avec qui j’étais, ou ce que je découvrais de moi-même. T’sais, aujourd’hui, je fais du cinéma, je fais de la poésie, pis là je fais du théâtre. J’aime performer, j’ai eu des bands. Y avait rien de tout ça qui existait, qui m’aiguillait à faire ça au secondaire. Y avait rien de ça qui apparaissait possible, c’était même pas des rêves, tellement c’était pas possible d’envisager ça. Mais y avait une genre d’attraction, quelque chose qui me tirait vers le cégep, vers x personne, dans débarquer dans un bar pour une soirée de slam, pis regarder tel ou tel film. Pis c’est vraiment ce pull-là, cet appel-là, que je pouvais pas comprendre pis raisonner, qui m’a amené où je suis en ce moment.
Si j’avais voulu mettre des mots, ou tracer mon parcours avant d’être rendu où j’étais à chaque moment, ça aurait été avec des « genre ». J’ai jamais anticipé ces affaires-là. Je suis allé parce que je pouvais pas pas y aller. Fallait que je dise oui à des affaires, pis là je suis là. C’est aussi rencontrer des gens. Vraiment. Ça fait toute la différence.
Reviendras-tu te recueillir dans la mousse à quatre pattes dans l’aube? (p. 78)
Oui. Pour moi, ça parle des commencements. Ça parle de la plus simple expression des commencements. Pis la réponse, c’est oui.
Quand je l’entends, c’est ce que ça veut dire. J’ai pas écrit ça de même, mais quand je l’entends, aujourd’hui, c’est ce que je comprends. La promesse que tout peut être réinventé différemment dans le recueillement où commence l’idée, la journée, la vie.
Switch de recueil?
Sure. Ça sera pas plus joyeux. Ben… Peut-être que oui, en fait (rires)
Ben je trouve pas ça malheureux, en fait.
C’est comme une journée de même. Je me sens de même.
Je veux pas que tu sentes que tu doives mettre un masque.
Écoute man, c’est as real as it gets.
Que ceux qui m’aiment me sauvent, maintenant. Pourquoi certaines amours prennent deux recueils de poésie pour mourir? (p. 12)
Parce qu’on veut pas les laisser partir par ce que ces amours-là sont une partie de nous autres. On est comme fusionnés à ces affaires-là. C’est dur de laisser partir l’amour, mais c’est encore plus difficile de laisser aller une partie de soi.
Qui a mis le feu dans mon ventre? (p. 45)
Mon père.
Es-tu fier de moi, maman? (p. 110)
Oui. Même si tu sais pas je suis qui, ni ce que je fais, pis que ça me fait chier.
M’attraperais-tu si ma chute t’écrasait? (p. 82)
C’est quelque chose qui se demande pas. C’est pas une question, c’est un avertissement.
Pourquoi ça pue? (p. 110)
(rires). C’est dans quel poème, ça?
C’est le même que « es-tu fier de moi, maman ».
Pourquoi ça pue? Parce qu’on a pas encore sorti toutes nos morts. C’est pour ça que ça pue.
Hey! Je peux répondre à la question que tu m’as posée. Tu sais, « celle que personne t’as jamais posée »?
Je pense que la question ce serait, genre, « pourquoi t’es pas devenu garagiste comme ton père? ».
Ça, c’est la question que personne ne me pose, et qui est surement au sens de mon existence.
Ça te tentes-tu de répondre à la question qu’on t’as jamais posée, là?
Je pense que j’ai pas eu le choix. Si j’avais eu le choix, j’aurais peut-être choisi de faire ça.
Pis je le sais qu’on choisit, pis qu’on peut recommencer sa vie à chaque journée où le soleil se lève, mais… Je pense que c’est le genre d’affaire qui est une genre de vérité factuelle, mais c’est pas la vraie vérité. C’est une vérité rationnelle.
Le cinéaste Bernard Herzog parle d’ecstatic truth. C’est le rapport qu’il fait avec une vérité qui dépasse le factuel. Genre « ouan, tu peux recommencer ta vie », mais la réalité, c’est que j’avais pas le choix. Je ne pouvais pas être mécanicien comme mon père.
Mais, mon père m’avait quand même dit : « fais jamais ça, c’est trop de misère. »
« Ça » étant garagiste?
Ouan. Mais je le sais pas si c’est moins de souffrance de raconter des histoires pis d’écrire des poèmes. Je le sais pas si on peut s’extirper de ça, ou si on nait avec ça pis on apprend à vivre avec. Genre, je sais pas si je recommanderais à mon kid de faire ça. En même temps, quand tu sens pas que t’as d’autres choix, y a pas vraiment de choix à faire. (…) Pis de temps en temps, on refait nos vœux avec le choix qu’on a fait. Work in progress.
Dostie et moi on s’est quittés quelques instants plus tard. Dans les semaines qui ont suivies, j’ai vu l’accueil enthousiaste sur les réseaux sociaux que suscitait la production à venir de Kiki et la colère avec grand bonheur. Et vu son film Boa être de la sélection au 78e festival du film de Locarno.
Œuvre citée : Dostie, Alexandre. Ceux qui m’aiment me sauvent. Ta Mère, 2022. (voir sur Librairie acadienne)
Citer cet article : Robichaud, Gabriel. « Un col bleu du storytelling : entrevue avec Alexandre Dostie ». Discours/e : Catalogue numérique des littératures et cultures de l’Atlantique, 28 juillet 2025. <>
Suivez Gabriel Robichaud sur Facebook.
Pour citer cet article:
Alexandre Dostie
Poète, performeur et cinéaste, Dostie est un autodidacte au parcours unique. Alors que ses films Mutants et Je finirai en prison sont présentés partout dans le monde, il publie deux recueils de poésie Shenley et Que ceux qui m’aiment me sauvent, qui l’amènent à performer au Canada comme à l’international. BOA, son nouveau court métrage coproduit avec la France, verra le jour en 2025. Dostie planche actuellement sur une première pièce de théâtre.

Gabriel Robichaud
Gabriel Robichaud est un artiste multidisciplinaire de Moncton qui a amorcé son parcours professionnel artistique en 2007. Fort d’un parcours académique en art dramatique à l’Université de Moncton, sa pratique multidisciplinaire le mène à toucher à la fois à la scène, à l’écriture et la mise en scène. Son choix d’ajouter une dimension politique à sa pratique, jumelé à des prises de positions sur la place publique, l’amène aussi à traiter de divers sujets concernant, les arts, la culture et la langue, particulièrement dans les médias.